Aristophane, poète grec du Veme siècle avant Jésus-Christ.
Il est l’auteur de comédies : pour ce que j’en connais, Aristophane est à la Grèce ce que Plaute est à Rome.
La plupart de ses textes sont perdus, sauf 11 comédies :
- Les Acharniens
- Les Cavaliers
- Les Nuées
- Les Guèpes
- La Paix
- Les Oiseaux
- Lysistrata
- Les Thesmosphories
- Les Grenouilles
- L’Assemblée des femmes
- Ploutos
Edition de référence :
Les Belles Lettres [par défaut]
Collection des Universités de France (CUF)
Texte établi par Victor Coulon et traduit par Hilaire van Daele
5 volumes
Texte bilingue, comme toujours pour cette collection.
35 € par volume, neuf, sauf le premier à 45 € (effectivement plus épais)
A vous de jouer maintenant !
Pour mémoire, l’édition citée est suivie de la mention [par défaut] qui apparaît s’il n’y a pas encore eu de discussion sur le sujet.
En commentaires, libre à vous de :
- discuter des mérites et défauts des différentes éditions
- de la place de l’auteur ou de l’oeuvre dans la culture de son temps
- de l’importance de l’auteur ou de l’oeuvre pour un lecteur contemporain
- de ce qu’il représente pour vous
- des livres ou autres sources très recommandables pour comprendre l’auteur / l’oeuvre / son influence
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !
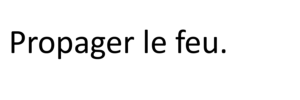
De la Comédie Ancienne (ἀρχαία κωμῳδία, ou Archaia), nous avons conservé une poussière de fragments souvent très brefs parmi lesquels émergent ceux de Cratinos, auquel les trouvailles papyrologiques ont été très favorables, au point qu’une monographie séduisante a pu soupeser les contours de sa figure ( Emmanuela Bakola, « Cratinus and the Art of Comedy », Oxford, Oxford University Press, 2010). Il n’en reste pas moins que le théâtre choisi que les Byzantins nous ont laissé pour son grand rival Aristophane seul permet de nous faire une idée précise de ce qu’étaient les comédies du Ve siècle athénien. Des deux manuscrits médiévaux anciens porteurs de ce choix dramatique, seul le Ravennas (Bibliotheca Classense 429 ; milieu du Xe siècle), coté R, contient les onze pièces aristophanesques sous une forme peu correcte mais sincère ; l’autre grand témoin, le Venetus Marcianus 474, coté V (seconde moitié du XIe siècle ou courant XIIe selon les opinions des paléographes), n’a que sept comédies. Le reste de la tradition est d’une complexité assez inextricable, en raison tant des recensions paléologiennes commises par les usual suspects Thomas Magistros et Démétrios Triclinios que du caractère mutilé ou de la date incertaine des deux derniers manuscrits qui antidatent la désastreuse conquête de Byzance par les Croisés en 1204 (un Ambrosianus, K, et un Matritensis, Mdl) ; plutôt que dans le résumé vraiment trop rapide de Nigel G. Wilson, « Aristophanea. Studies on the Text of Aristophanes », Oxford / New York, Oxford University Press, 2009, pp. 1-10), on en prendra la mesure en feuilletant la version révisée de la dissertation de Charles N. Eberline sur les Oiseaux (« Studies in the Manuscript Tradition of the Ranae of Aristophanes », Meisenheim-sur-Glan, Hain, 1980 ; le seul catalogue des sources manuscrites occupe les p. 1-45, avec les notes en 163-164). La première édition vraiment critique d’Aristophane fut confectionnée par un savant anglais, le révérend Frederick H. M. Blaydes, qui a édité chaque pièce avec un apparat des variantes manuscrites où tous les témoins qui les portent sont placés sur le même plan (!), les scholies alors connues, et surtout un très riche commentaire textuel qui tient malheureusement du déballage de fiches (Halle, librairie de l’Orphelinat, 1880-1893, 11 vol.). La critique textuelle s’y montre d’une liberté à la limite de la désinvolture ; mais l’auteur a lu toute la littérature grecque, il met le doigt sur nombre de difficultés bien réelles à côté de beaucoup trop de problèmes imaginaires, et procure une profusion de parallèles dans laquelle toute la recherche ultérieure a puisé en silence. L’un des meilleurs élèves du grand Cobet, le néérlandais Jan van Leeuwen, éditeur valeureux d’Homère et très bon grammairien lui aussi, avec davantage de jugement que Blaydes, refondit le patron de l’édition de Halle en limitant la base diplomatique à R, qu’il reproduisit en phototypie en 1904, et à V, en donnant un apparat critique allant à l’essentiel, et en ajoutant en bas de page un commentaire perpétuel à la fois critique et exégétique (Leyde, Sijthoff, 1893-1906, 11 vol. plus un de prolégomènes ; on lui doit un grand nombre de bonnes interprétations et d’admirables corrections textuelles). L’édition de l’Oxford Classical Texts par F. W. Hall et W. M. Geldart, 2 vol., 1906, est commode et maniable mais ne présente guère de progrès. Ceux-ci vinrent de l’édition Budé mise en chantier par l’excellent philologue strasbourgeois né français Victor Coulon, que sa formation philologique germanique mit à même de proposer à la fois un large décantage de la tradition basé sur des collations renouvelées d’un plus grand nombre de manuscrits et un renouvellement du texte par un choix judicieux de leçons transmises et de corrections (1926 pour les tomes 1 à 4, 1930 pour le cinquième). Il couronna son oeuvre par une thèse française où il appliqua la Textkritik trop systématique et mécaniste de Louis Havet : « Essai sur la méthode de la critique conjecturale appliquée au texte d’Aristophane », Paris, Les Belles Lettres, 1933. Premier vrai travail savant qu’accueuillit la collection, cette Budé a servi de référence pendant une quarantaine d’années (l’édition bilingue lancée par Raffaele Cantarella en 1949 n’aboutit qu’à la parution d’un volume de prolégomènes et deux volumes de texte, plutôt médiocres). En éditant les Nuées en 1968 avec ce qui restera comme l’un des commentaires les plus denses et habiles des études classiques d’après-guerre pour la Clarendon Press, Kenneth Dover devait mettre en évidence toute une série de jugements erronés et de fautes dans la vision de la Textüberlifierung proposée par Coulon. La polémique autour de tel ou tel manuscrit byzantin d’Aristophane, le feu roulant de bonnes éditions critiques et commentées en langue anglaise impulsées par Dover tant par son enseignement que par son rôle officieux de sospitator d’Aristophane à la Clarendon Press, la splendide thèse de Jean Taillardat sur « Les images d’Aristophane » (1965), qui corrige beaucoup de passages difficiles ou mal compris, ont donné suffisamment d’actualité à l’étude de la tradition manuscrite pour susciter deux nouvelles intégrales : l’une anglaise, aux ambitions modestes en particulier sur le plan de l’établissement du texte mais commode pour le lecteur non helléniste et qui, s’améliorant au fil du temps, devint très bonne, par Alan H. Sommerstein (Warminster, Aris & Phillips, 1980-2002, 11 vol. plus un d’index), l’autre italienne, toujours en cours (collection de la Fondation Lorenzo Valla, chez Mondadori à Milan, 1985 sqq. : 5 vol. parus) et plus savante. Wilson, enfin, nous a donné l’editio vere critica, l’intégrale vraiment critique, caractérisée par une grande maîtrise philologique et un flair poétique incontestable : la nouvelle Oxford Classical Text (« Aristophanis fabulae », 2 vol., 2007), avec préface anglaise ; la justification de la plupart de ses innovations textuelles (il propose une bonne centaine de conjectures) se trouve dans les « Aristophanea » déjà cités. Il faut signaler la qualité de son texte, car un médiocre philologue néerlandais a bavé sur cette oeuvre avec des arguments susceptibles d’impressionner des lecteurs peu avertis, dans un compte rendu développé (Remco F. Regtuit, in Mnemosyne 64, 2011, pp. 486-493).
Une édition critique et commentée moderne de type maior existe désormais pour quasiment chacune des comédies ; les meilleures sont celles oxoniennes de Colin Austin (avec S. Douglas Olson, Thesmophories, 2004) ; Dover (Nuées ; Grenouilles, 1993) ; Nan Dunbar (Oiseaux, 1995 [un monument]) ; Douglas McDowell (Guêpes, 1971) ; Jeffrey Henderson (Lysistrata, 1987) ; et Roger Ussher (Assemblée des femmes, 1973). Le même Olson a signé, toujours à la Clarendon Press / Oxford University Press, des éditions fort compétentes, mais à mon sens moins pleines de brio, de la Paix (1998), des Acharniens (2002) et des Guêpes (avec Zachary Biles, 2015) en attendant ses Cavaliers. Le commentaire de Sommerstein présente le grand mérite de ne supposer aucune connaissance du grec, puisque les appels de notes se font conformément à sa traduction ; il s’intéresse surtout à la civilisation et à la mise en scène, comme fit en son temps le Belge Alphonse Willems dans l’annotation étendue et volontiers caustique de son travail posthume « Aristophane. Traduction avec notes et commentaires critiques », Paris / Bruxelles, Hachette, 1919, 3 vol. Le commentaire italien de l’intégrale Valla fait en quelque manière figure de compromis entre cette tendance à expliciter la dimension matérielle et historique du texte et l’approche savante des travaux oxoniens ; c’était se condamner à ne satisfaire aucun de ces deux types de lecteurs.
Traduire Aristophane tient de la quadrature du cercle. Superbe écrivain et métricien virtuose (voir Laetitia Parker, « The Songs of Aristophanes », Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 3-17), le poète cultivait la liberté propre à la Comédie Ancienne en ne reculant devant aucune allusion scatologique ou obscène, aucune gaudriole sexuelle. Cela l’a fait condamner à des rendus pudibonds jusqu’à une date assez récente au cours du XXe siècle (la meilleure référence, hélas peu connue, est ici : http://urlz.fr/6pk9). Les deux traductions françaises classiques sont celles de Willems, très vieillie tant en raison des dogmes du cant de l’époque que de son style pâteux et lourd, et et d’Hilaire van Daële face au texte grec de Coulon dans la C.U.F., plus fluide, plus académique et sérieuse aussi, mais qui recèle de nombreux bonheurs d’expression quant on y regarde de près (on peut lui reprocher d’avoir reformulé Willems, tant il le suit dans les limites que lui imposait la constitution textuelle de Coulon, ainsi que de manquer fort d’humour ; c’est à ce titre que Marcel Caster, qui fut un très bon connaisseur, appelait Van Daële « le bien nommé » [= Vandale]). Marc-Jean Alfonsi a donné une version aux Classiques Garnier (1932-1933, 2 vol.) où l’on trouvera davantage, mais pas tellement plus, de nerf et d’aisance que dans la collection Budé, dont il ne fait aucun doute qu’il s’est presque exclusivement inspiré. Maurice Rat a fait mieux dans ses 4 vol. (Paris, Union Latine d’Editions, 1947), mais, comme dans la traduction des tragédies de Sénèque par Florence Dupont, on se gardera d’y chercher trop de scrupules philologiques. Malgré les objections des universitaires un peu trop sourcilleux devant les adaptations modernisantes des institutions, des objets courants et des dieux dont nous entretient Aristophane comme devant les vers de mirliton, c’est l’Aristophane francisé avec une verve joyeuse et un style admirable par Victor-Henry Debidour pour Le Livre de Poche (1965-1966, 2 vol., notamment réimprimés dans la collection Folio de Gallimard) qui mérite les plus grands éloges : le sens du grec y est fort bien étudié et rendu avec une ingéniosité qui force l’admiration ; enfin peut-on avoir une idée française, fût-elle approximative, de la polymétrie aristophanesque. La traduction Pléiade du spécialiste d’Aristophane Pascal Thiercy (1997) se présente accompagnée d’un impressionnant appareil de science, fort inaccoutumé pour cette collection ; elle se veut critique, en ce sens que l’auteur a établi son propre texte en fournissant, pour chaque comédie sauf pour les Acharniens, qu’il édita lui-même auparavant, une liste plus ou moins longue de divergences par rapport à son éditeur de référence. Elle a reçu des remarques fort respectueuses de la part de bons juges (http://urlz.fr/6pki) ; en vérité, Thiercy est un piètre critique textuel par surcroît peu compétent en métrique (Wilson, « Aristophanea », ne rate pas une occasion de rectifier ses erreurs, en insistant sur les fautes de morphologie ou de scansion qui invalident les conjectures personnelles de son collègue français), et son refus de versifier et de rimailler les parties lyriques des comédies aboutit à un texte plat, ennuyeux et insipide. On lira cette Pléiade pour ses notices et ses notes de civilisations ainsi que pour prendre une idée de ce que dit Aristophane toutes les fois où l’on pourra juger que Debidour va trop loin en modernisant ou en transposant.
Je vais me permettre de citer intégralement Alain Blanchard dans la Revue des Études Grecques (Année 1998 111-2 pp. 783-784). Ce « compte-rendu bibliographique » résume parfaitement et exprime bien mieux que je ne le ferais mon ressenti de lecteur du théâtre d’Aristophane dans l’édition Pléiade.
« Il faut saluer avec reconnaissance la publication, dans la prestigieuse « Bibliothèque de la Pléiade », d’une traduction française nouvelle des onze comédies conservées d’Aristophane. Jusque-là le public cultivé disposait en fait de deux grandes traductions : celle qu’A. Willems avait publiée en 1919 (avec son succédané par H. van Daele dans la CUF, 1923-1930) et celle de V.-H. Debidour (1966). La première, très exacte en son temps, est maintenant vieillie, et la seconde, dans son souci de préserver la vie de l’original, tient souvent de l’adaptation plus que la traduction. Dans la « Pléiade », P. Thiercy a parié pour l’exactitude sans renoncer à être vivant, et je pense qu’il a gagné son pari.
Son souci d’exactitude — qui apparaît dès la traduction de deux titres (les Thesmophorieuses et non les Thesmophories, les Femmes à l’Assemblée et non Y Assemblée des Femmes) — , l’a amené avant tout à consentir un gros travail sur le texte même de l’original grec : on en prendra conscience en consultant la « note sur le texte » qui accompagne en fin de volume chaque comédie et où l’auteur signale les leçons adoptées par rapport à telle ou telle édition (Coulon pour les Cavaliers et le Ploutos, Dover pour les Nuées, Macdowell pour les Guêpes, Platnauer pour la Paix, Kakridis pour les Oiseaux — l’édition de Nan Dunbar, en 1995, est arrivée trop tard — , Henderson pour Lysistrata, Sommerstein pour les Thesmophorieuses, Del Corno, préféré finalement à Dover, pour les Grenouilles, Vetta pour les Femmes à l’Assemblée ; pour les Acharniens, P. Thiercy renvoie à sa propre édition, publiée en 1988) : la tendance générale est de corriger le moins possible le texte des manuscrits, surtout en cas d’accord de R. et de V, mais aucune règle n’est appliquée mécaniquement et c’est un éclectisme de bon aloi qui prévaut. Cela est particulièrement sensible dans le domaine de la répartition des répliques, domaine auquel, depuis longtemps, P. Thiercy, a porté une attention particulière (voir ainsi sa communication au colloque de Toulouse publiée dans Pallas, xxxviii, 1992). Dans la traduction proprement dite — en prose mais observant par sa disposition le découpage des vers de l’original — , on sera sensible au respect des différents niveaux de langue, depuis le style tragique jusqu’à l’obscénité et la bouffonnerie : on pourrait multiplier sans fin les exemples de réussites particulières. De même le traducteur a voulu et su faire sentir l’évolution du poète d’une pièce à l’autre, depuis l’exubérance des créations verbales que l’on observe dans les premières comédies jusqu’à la tonalité plus grisâtre des dernières pièces. Les jeux de mots d’Aristophane sont rendus au prix de quelques manipulations des mots français… et de notes explicatives.
Plus largement, les éléments de commentaire révèlent l’intention profonde du traducteur. Ils consistent d’abord, pour chaque comédie, en une notice de présentation assez développée où P. Thiercy reprend les analyses qu’il avait présentées dans sa thèse sur Aristophane : fiction et dramaturgie, parue aux Belles Lettres en 1986 : cette notice met en valeur la structure dramatique de l’œuvre, la nature de son héros et du chœur, et, au-delà, l’implication du spectateur dans le drame représenté. Une « note sur la mise en scène » précise ensuite la structure du décor et la répartition des différents rôles entre les trois acteurs parlants. Dès l’introduction au volume entier, P. Thiercy avait précisé avec soin les conditions de la première représentation d’une comédie d’Aristophane, qu’il s’agisse de l’architecture du théâtre, des machines employées, du personnel et du public. Cette prépondérance donnée à l’élément technique surprendra peut-être ceux qui attendaient une analyse plus engagée de la carrière d’Aristophane. Mais il faut reconnaître qu’elle donne à tout l’ouvrage, outre une plus grande unité, une grande objectivité et une grande solidité P. Thiercy n’a pas d’autre ambition que de montrer qu’Aristophane est un grand homme de théâtre et il y réussit pleinement.
Sa tentative est à la fois paradoxale et très riche. D’un côté, l’ouvrage est fort savant : plus de trois cents pages de notes en petits caractères, une chronologie, une longue bibliographie sélective (arrêtée en 1995), un index des notes de civilisation, l’ensemble représentant un très gros travail dont le recenseur ne prétend pas donner même une grossière idée. Mais toute cette science n’a d’autre but que de faciliter l’accès du lecteur moderne à cette poésie comique ancienne. P. Thiercy a en effet la conviction qu’elle peut nous toucher encore : tant sa puissance transcende les conditions politiques et culturelles qui l’ont vu naître. Cette conviction s’est affermie en lui quand il a fait jouer par ses étudiants plusieurs des comédies ici traduites. C’est sans doute également le secret de la réussite de cette traduction : le texte doit pouvoir être dit par un acteur, et dans le lecteur, le spectateur potentiel n’est jamais oublié. Ce « Pléiade » donne vraiment un grand bonheur, même s’il fait délibérément imaginer que voir et entendre au théâtre ce qu’on est en train de lire serait un plus grand bonheur encore. »