Eschyle (vers 525 avant J.-C. à 458 avant J.-C.) fait partie de la « trilogie des dramaturges » de la Grèce antique, que l’on retient dans l’ordre chronologique suivant :
Eschyle (tragédie en germe)
suivi de Sophocle (tragédie à maturité)
suivi d’Euripide (décadence de la tragédie)
La réalité est un peu plus complexe : Eschyle n’est le premier que parce que les quelque 32 tragédies conservées de ces auteurs ne représentent que quelques pièces sur un ensemble beaucoup plus vaste (220 environ pour ces trois auteurs ; 648 tragédies présentées aux Grandes Dionysies) ; Sophocle qui est présenté avant Euripide nous a pourtant laissé la dernière pièce conservée, etc.
Ce qui est certain : les pièces de ces auteurs sont des références culturelles immenses qui ont traversé les âges et nourri toute la littérature, et plus généralement, tous les arts jusqu’à notre époque.
Quelques titres :
L’Orestie
Les Perses
Les sept contre Thèbes
Edition de référence :
Les Belles Lettres [par défaut]
Collection des Universités de France (CUF)
Tragédies en deux volumes.
Texte bilingue, comme toujours pour cette collection.
Un peu plus de 40 € le volume.
Le volume 1 est noté « en réimpression » chez l’éditeur.
Noter qu’Eschyle a été édité en Pléiade dans un volume « Tragiques Grecs » qui le place dans un volume aux côtés de Sophocle (Euripide faisant l’objet d’un volume séparé).
Livre(s) très recommandables :
- Le tombeau d’Oedipe, de William Marx : est une réflexion extrêmement intéressante et accessible sur ce qu’est la Tragédie grecque, sur la perception faussée que l’on peut en avoir.
A vous de jouer maintenant !
Pour mémoire, l’édition citée est suivie de la mention [par défaut] qui apparaît s’il n’y a pas encore eu de discussion sur le sujet.
En commentaires, libre à vous de :
- discuter des mérites et défauts des différentes éditions
- de la place de l’auteur ou de l’oeuvre dans la culture de son temps
- de l’importance de l’auteur ou de l’oeuvre pour un lecteur contemporain
- de ce qu’il représente pour vous
- des livres ou autres sources très recommandables pour comprendre l’auteur / l’oeuvre / son influence
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !
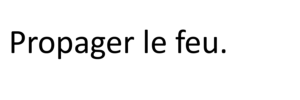
En sus de nous proposer un théâtre d’essence hiératique et sublime, couché dans une langue concentrée, tendue, hardie et difficile, qui serait délicate à comprendre et traduire même si le propre exemplaire d’auteur de telle ou telle tragédie nous était miraculeusement restitué, Eschyle est le Tragique grec dont le texte nous a été le moins bien transmis. Deux vieux manuscrits médiévaux seulement sont porteurs l’un des sept pièces conservées, le codex Mediceus (Laurentianus 32. 9, milieu du Xe siècle), l’autre, malheureusement perdu mais connu par 150 manuscrits fils, ou apographes, des XIIIe, XIVe et XVe siècles, dont la quasi-totalité ne donnent que trois pièces (c’est la Triade byzantine : Prométhée, Perses, Sept contre Thèbes) rejointes dans un très petit nombre d’autres par Agamemnon et les Euménides. Les trouvailles papyrologiques ont été assez chiches envers Eschyle : non seulement elles ne sont pas très abondantes, contrairement à ce qui se passe pour Euripide, de très loin le poète dramatique le plus goûté de l’Antiquité gréco-romaine, mais elles recoupent beaucoup moins souvent qu’on le voudrait nos sept pièces – comme elles nous rendent essentiellement des bribes de drames eschyléens perdus, leur utilité est donc faible pour établir le texte du théâtre choisi que nous avons. Il en va de même des citations (ce que l’on appelle ‘tradition indirecte’, ou ‘collatérale’). Pour comble de maux, le grec tendu d’Eschyle nous a été transmis dans un état assez lamentable, en partie dans les parties chantées (stasima) : des pièces comme Agamemnon et surtout les Suppliantes comportent un assez grand nombre de passages où le sens ne se laisse même pas deviner, tellement ce qui se lit sur le Mediceus, avec ou non l’appoint d’apographes de l’autre manuscrit ancien, soit sémantiquement ou grammaticalement absurde soit inacceptable sur le plan de la versification (souvent même les deux catégories se cumulent). Pour dater de 950 environ, le Mediceus est hélas loin de montrer l’excellent pedigree textuel, latin ‘indoles’, d’autres manuscrits contemporains, comme le codex A de l’Iliade, le Venetus (Marcianus Graecus 454), ou nettement plus anciens, tels les codex A et B de Platon, le Parisinus 1807 (environ 850-875) et l’Oxoniensis Clarkianus 39 (terminé en 894) ; quant aux apographes, leur texte est souvent exécrable. En d’autres termes, la tâche de l’éditeur est peu enviable : lorsqu’il dispose du Mediceus, il obtient un texte remontant certes à l’Antiquité tardive ou au Haut Moyen-Âge mais qui reste fort mal épuré et auquel les éventuels apographes contribuent très peu de variantes qui soient autre choses que des fautes ou des retouches scribales grossières ; quand il n’en dispose pas (car le Mediceus est mutilé), il faut s’efforcer de tirer des apographes un texte tenant debout dont on ne peut jamais savoir s’il est authentique et dans quelle mesure il remonte au second manuscrit médiéval ancien, le prototype perdu. En effet, Eschyle était populaire à Byzance à l’époque de la Renaissance paléologienne et a fait l’objet d’un important travail critique aux mains de trois grands grammairiens grecs soucieux de sauver de l’héritage classique ce qui pouvait encore l’être : Thomas Magistros (extrême fin du XIIIe siècle ?), Manuel Moschopoulos (mort après 1316) et surtout Démétrios Triclinios (mort après 1340), le plus hardi de tous, personnage ayant la correction facile et que sa vantardise poussait à signer certaines de ses interventions dans les scolies. Ces personnages ont influé, dans une mesure importante (bien que les détails restent flous), sur les manuscrits tragiques de cette époque ; au point qu’on connait au moins deux états byzantins du texte eschyléen, l’un thomanien, l’autre triclinien. En d’autres termes, les manuscrits récents de la Triade byzantine, et aussi les autres, comportent des leçons qui ne doivent pas remonter au prototype perdu cousin du Mediceus ; on imagine volontiers les sueurs froides que l’utilisation de cette branche de la tradition peut générer chez l’éditeur scrupuleux. Une seule pièce échappe à ce lot commun : le Prométhée, écrit dans une langue beaucoup moins concentrée et qui, du fait qu’il vient en tête de la Triade byzantine, fut copié par des scribes au sommet de leur attention (on sait que la qualité de tout long travail de copie diminue à mesure qu’on avance dans la tâche, avec une attention maximale au tout début).
Bien entendu, la philologie n’a pas attendu de déterminer la filiation des manuscrits eschyléens pour en donner des éditions qui furent convenables pour leur époque. Ces travaux restent utiles principalement comme répertoires de corrections textuelles ; mais c’est seulement avec le Titan de la philologie classique Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff qu’Eschyle a été doté d’une édition basée tout ensemble sur une exploration convenable des sources documentaires et sur un effort de correction méthodique du texte (« Aeschyli tragoediae », Berlin, Weidmann, 1914) . Les faiblesses n’en sont apparues qu’à l’usage : collations hâtives, voire souvent fautives, des manuscrits, méthode critique péremptoire marquée par un certain dédain de virtuose pour l’explication de la faute supposée. Cette oeuvre splendide fut pillée tant par Gilbert Murray dans son Oxford Classical Text (« Aeschyli septem quae supersunt tragoediae », 1937 [très mauvaise à tous égards], refaite en 1955 [texte devenu raisonnable, apparat fautif et criblé d’erreurs d’attributions de corrections]) que par Paul Mazon pour sa Budé. Entre la présentation fallacieuse, voire incompétente, de la tradition manuscrite dans l’introduction, l’apparat rédigé d’une manière, osons le mot, délirante, et le texte tellement conservateur que Mazon, pour pouvoir traduire, se permet souvent de sous-entendre une correction présente chez Wilamowitz qu’il ne cite pas dans l’apparat, le tome I de cette édition Budé ne mérite pas d’être considéré comme scientifique. Le tome II, contenant l’Orestie, est de caractère différent : moins inféodé à Wilamowitz et donnant des collations personnelles du Mediceus ainsi que des notices plus détaillées, sinon dépourvues de fautes, l’édition Mazon d’Agamemnon, des Chéophores et des Euménides présente un certain intérêt. Elle reste toutefois bien conservatrice et dépourvue d’idées personnelles pour améliorer le texte, à la différence de la seconde édition Murray. Cette dernière a été refaite par Denys L. Page, qui fut le meilleur éditeur de textes poétiques grecs de la période 1940-1978 ; Page exploita la grande enquête sur les bases documentaires effectuée par son élève Roger D. Dawe (« The Collation and Investigation of Manuscripts of Aeschylus », Cambridge, Cambridge University Press, 1964, qui détruisit la tentative prématurée d’Aleksander Turyn « The Manuscript Tradition of the Tragedies of Aeschylus », New York, Polish Institute, 1943) et améliora le texte par un choix de corrections supérieur à ceux de Wilamowitz et Murray², mais son apparat est très difficile à lire. Reprenant le travail dans son édition Teubner, Martin L. West rectifia l’image de la tradition proposée par Dawe et offrit un texte qui valait par un grand nombre de corrections personnelles, presque toutes intéressantes : « Aeschyli Tragoediae cum incerti poetae Prometheo », Stuttgart 1990, reproduit avec des changements (mineurs) en 1998 et prolongé par un gros volume complémentaire de « Studies in Aeschylus », Stuttgart, Teubner, 1990. West est le premier éditeur a condamner franchement pour motif de bâtardise le Prométhée, dont l’attribution fautive à Eschyle fait de moins en moins de doutes désormais (en ce sens que les tentatives visant à défendre l’attribution traditionnelle, par C. J. Herington, Maria P. Pattoni, Suzanne Saïd, en sont réduites à couper les cheveux en cinquante).
Pour chaque tragédie eschyléenne préservées en tradition directe, il existe d’excellentes éditions critiques et commentées, qui offrent en général un texte de grande qualité : l’Agamemnon par Eduard Fraenkel (Oxford, Clarendon Press, 1950, 3 vol.) est resté célèbre pour la monumentale érudition de son commentaire (2 vol. et 1000 pages), même s’il a vite été remis à sa place par la petite mais très judicieuse et solide édition de J. D. Denniston terminée par Page (Oxford, Clarendon Press, 1957). Tout aussi encyclopédiques sont les Suppliantes par Holger Friis-Johansen et Edward W. Whittle, s.l. [Copenhague], Akademisk Forlag, 1980, 3 vol. (850 p. de commentaire). Plus courtes, car tenant en un seul volume petit format, mais également superbes, les deux éditions des Perses par Henry D. Broadhead (Cambridge, Cambridge University Press, 1960) et Alexander F. Garvie (Oxford, Oxford University Press, 2009), ainsi que celle des Choéphores par le même Garvie (ibid., 1986). Tout ce que la France peut opposer tient dans la grosse édition commentée des Perses par Louis Roussel (Montpellier, Université de Montpellier, 1960) ; or ses bizarreries empêchent qu’on la prenne au sérieux : l’auteur se montre d’une arrogance envers tous ses devanciers que seule dépasse la haute estime qu’il a pour lui-même, il multiplie les censures arbitraires envers le poète, les corrections que rien n’autorise sinon ses propres théories fantaisistes sur la versification grecque ou la prononciation de la langue, les normalisations grammaticales qui ne sont autres que chicanes de grammairien mal luné méconnaissant l’idiome tragique (Roussel a très peu lu la littérature secondaire). Il ne s’agit pas de piétiner un auteur qui, à sa manière, mérita bien du grec, mais de mettre les choses au point car la seule recension française de ce livre a fait montre d’une extrême flagornerie (http://urlz.fr/6lt5 : le recenseur était alors un simple thésard qui voulut ménager un vieux maître provincial). Presque aussi mauvaise est l’édition commentée monumentale de l’Agamemnon lancée dans les années 70 par Jean Bollack (parties lyriques, ou stasima) et à laquelle son collaborateur Pierre Judet de la Combe a ajouté les dialogues en 2001 : « L’Agamemnon d’Eschyle : le texte et ses interprétations », aux Presses universitaires de Lille, devenues les Presses universitaires du Septentrion. Son parti-pris de conservatisme textuel extrême (sous les justifications philosophiques, le mot d’ordre est « respecte toujours le texte des manuscrits, si mauvais soit-il », car Bollack se figure que plus un texte est difficile, moins il a été corrigé au cours de la transmission [!]) se cumule avec une incompétence flagrante en matière de versification lyrique et un extraordinaire mépris envers les acquits de la critique textuelle classique pour nous valoir une édition jonchée de bizarreries, de faux-sens, d’amphibologies défendues au fil d’un commentaire qui tient à la fois du déballage de fiches et de la dissertation herméneutique bourrée de jargon ; la traduction elle-même est belle et pleine de souffle, mais tient de la manipulation imposée au lecteur.
Il m’est impossible de recommander une traduction française d’Eschyle, car celles qui existent sont soit anciennes, soit réalisées d’après des éditions trop datées ou médiocres pour faire autorité (ainsi le Classique Garnier de l’excellent Emile Chambry, dont le rendu selon moi offre la plus grande fluidité, repose sur le grec de Mazon comparé avec celui de la première édition Murray). Mazon, dont le français l’emporte sans discussion sur toutes celles qui sont venues avant et après lui, exige qu’on le prenne avec des pincettes plus encore que les autres, compte tenu de la manière avec laquelle il a établi sa traduction et le texte qui lui fait face. Il est hautement malheureux que la dernière version complète en date, celle de Victor-Henri Debidour, traducteur valeureux d’Aristophane, dépende du grec de son édition Budé (« Les tragiques grecs », Paris, La Pochothèque, 1999), tout comme la partie eschyléenne du volume de la Pléiade traduit par Jean Grosjean avec notices et notes de Raphaël Dreyfus. Je suggère de se procurer la nouvelle édition Loeb, établie par le fin connaisseur qu’est Alan H. Sommerstein (2008, 3 vol. dont 1 de fragments) : le texte des tragédies conservées repose sur la Teubner de West non sans indépendance.
Eh, bien… Quand j’écrivais que ce site dépassait mes compétences littéraires et que je le laissais ouvert aux plus sachants que moi, je n’imaginais pas à quel degré j’étais dans le vrai.
En effet malheureusement la meilleure édition est celle de Sommerstein chez Loeb qui a en outre écrit deux commentaires édités chez Cambridge Greek and Latin Classics, l’un concernant les Euménides et l’autre les suppliantes datant de l’année dernière et qui est remarquable.
A noter aussi « The Agamemnon of Aeschylus: A Commentary for Students » de David Raeburn qui est beaucoup moins « fouillé » que le commentaire de Fraenkel mais plus complet que celui de Page et comme son titre l’indique est fort utile à l’étudiancar il met l’accent sur la grammaire et le langage de cette pièce fascinante mais assez complexe.
Je viens de terminer Les Sept contre Thèbes, l’Orestie, Promethée enchaîné et les Suppliantes!
Mais j’hésite vraiment à lire les Perses, la pièce me semble être moins « valable » que les autres. Pour des raisons qui me sont personnelles (donc il s’agit peut-être d’un jugement arbitraire).
J’ai peiné à lire les Sept conre Thèbes, la pièce m’a semblée figée, immobile… De même, les Suppliantes m’a paru un peu décousu (comme si Eschyle avait manqué d’inspiration)
Enfin, je m’apprête à me procurer ce Weekend cinq tragédies de Sophocle (qu’il me semble pertinent d’évoquer lorsqu’on parle d’Eschyle, parce que Eschyle c’est bien le dévouement à sa patrie, la religion tout ça mais Sophocle c’est quand même mieux ficelé pour parler vulgairement), et à mon sens, Sophocle a eu en son temps dans son esprit une … comment dire ? Virtuosité, un génie, quasiment une lucidité de ce qu’est la perfection.
Je n’en dirait pas plus par peur d’outrager les dieux par des anachronismes, des comparaisons à travers les millénaires qui me viennent à l’esprit, mais qui n’ont assurément pas leur propos dans ces commentaires.